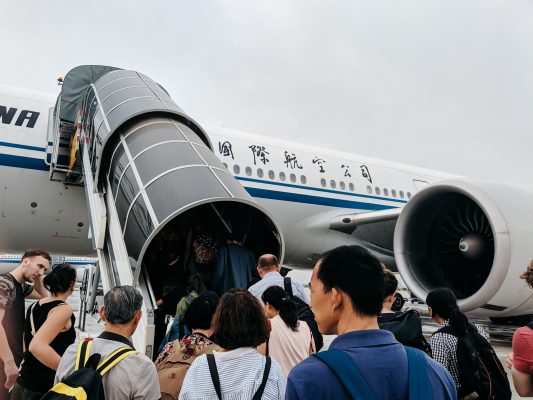Mes complexes
Ce n’est jamais simple de dévoiler ses complexes, les miens ne font pas exception à la règle, bien que… enfin, lisez et vous verrez par vous-mêmes.

Au spécialiste des coccolithophores qui parle avec passion de son objet d’étude, on tire son chapeau sans pour autant avoir compris un traitre mot de ce qu’il avançait. On excuse le charabia de l’ingénieur aérospatial parce que ce qu’on attend de lui, avant tout, c’est qu’il calcule au mieux les trajectoires, les portances et résistances des matériaux, pas qu’il vulgarise à l’extrême l’objet de sa science.
Au médecin, on pardonne déjà moins l’incompréhensibilité des propos. Bien sûr, nous construisons notre confiance en lui en partie sur l’apparente intelligence de ses paroles mais parce qu’il traite de notre corps, parce que nous voulons mettre des mots sur une douleur inexplicable, nous attendons de lui qu’il soit en mesure de nous rendre accessible son érudition.
Du professeur en revanche, quelle que soit la matière qu’il enseigne, on attend toujours la meilleure capacité de vulgarisation. Peu importe si son intelligence ou ses connaissances sont hors du commun : s’il n’est pas en mesure de mettre ces difficiles savoirs à la portée de son auditoire, c’est un mauvais professeur.
Pédagogues et démagogues
Jusqu’à il y a un an, je m’efforçais donc d’exercer cette dernière mission avec le plus de professionnalisme possible et je dois bien l’avouer, ce challenge pédagogique, sans prétendre l’effectuer au mieux, avait au moins le mérite de me plaire énormément.
Puis j’ai choisi d’emprunter une voie nouvelle qui allait me mettre au pied d’un nouveau mur presque infranchissable, celui du responsable politique face à la complexité.
D’un responsable politique, chacun·e est en droit d’exiger qu’il exprime avec la plus grande clarté les décisions qu’il prend, les motivations qui l’animent, les positions qu’il assume. En campagne, l’aspirant politique a martelé des slogans souvent simples, faciles à mémoriser, on a retenu ces beaux discours, on attend de voir s’ils soutiennent l’épreuve de la réalité.

Propulsés dans les rangs des décideurs, bien trop souvent les hommes et femmes politiques se sont alors prétendus professeurs. Pour expliquer telle décision politique, il allait s’agir de « faire œuvre de pédagogie ». Leurs réformes étaient critiquées ? C’était parce qu’elles n’avaient « pas été assez expliquées ». Le peuple s’est alors senti méprisé, infantilisé. Peut-on lui donner tort ?
D’autres ont fait un choix plus grave encore, celui de conserver, une fois aux commandes, la même apparence de simplicité qui avait animé leurs discours : avant leur élection, ils prétendaient qu’il « n’y avait qu’à… » À l’épreuve des faits, ils allaient s’efforcer de faire rentrer la complexe réalité dans la simplicité de leurs mots. Peu importe que la réalité leur donne tort. On appellerait « populistes » ces démagogues, comme si le peuple était responsable de la lâcheté de ses nouvelles élites.

Une pelote de fils
J’étais plongé dans la contemplation anxieuse de ces deux précipices quand, à pas feutré, un vieil homme presque centenaire vint s’asseoir à côté de moi. Silencieux, il écouta ma plainte naïve et puérile sur la complexité des organisations humaines.
« Qu’il s’agisse d’amener un budget à l’équilibre, de renforcer la solidarité envers les personnes âgées ou de réguler une population de sangliers, aucun sujet n’échappe à sa batterie de règles, ses logiques internes et surtout ses interconnexions avec à peu près… tous les autres aspects de la vie en société.
« Pour chaque thématique, l’homme ou la femme politique devrait en même temps en être expert avisé et avoir le recul nécessaire à une vision globale. Le grand écart est permanent et à l’heure de tenter de l’expliquer, j’ai l’impression d’être devant une pelote de fils entremêlés impossible à démêler avec la furieuse tentation d’affirmer qu’au fond, je n’y comprends rien. »
« Une pelote de fils ? » me dit-il. « Oui, enfin, c’est une image… ».

Éloge de la pensée complexe
Comme le font souvent les vieillards qui savent pudiquement retenir leur sagesse et feindre la candeur, il m’apprit alors que le mot « complexe » désignait, à l’origine « ce qui est tissé ensemble » et que la pensée complexe qu’il développait depuis un peu moins d’un demi-siècle consistait précisément à ne pas démêler les fils mais à voir de quelle manière ils étaient reliés pour former une tapisserie unique. Ni simplifier à outrance, ni fermer les yeux sur la complexité mais l’assumer pleinement.
J’en étais à m’apprêter à lui dire que cela me faisait une belle jambe quand il me devança et prit la parole ? « Ce qu’il te reste à faire ? Relier. Ne jamais nier la complexité du monde pour flatter la paresse intellectuelle. Ne céder ni à la prétendue pédagogie, ni à la démagogie. Gager que chacun fera sa part d’efforts pour voir les liens qui nous unissent. Parce que le seul travail politique qui vaille la peine, c’est précisément celui qui plonge à corps perdu dans le complexe et qui, contre vents et marées, cherche ce qui nous relie. »