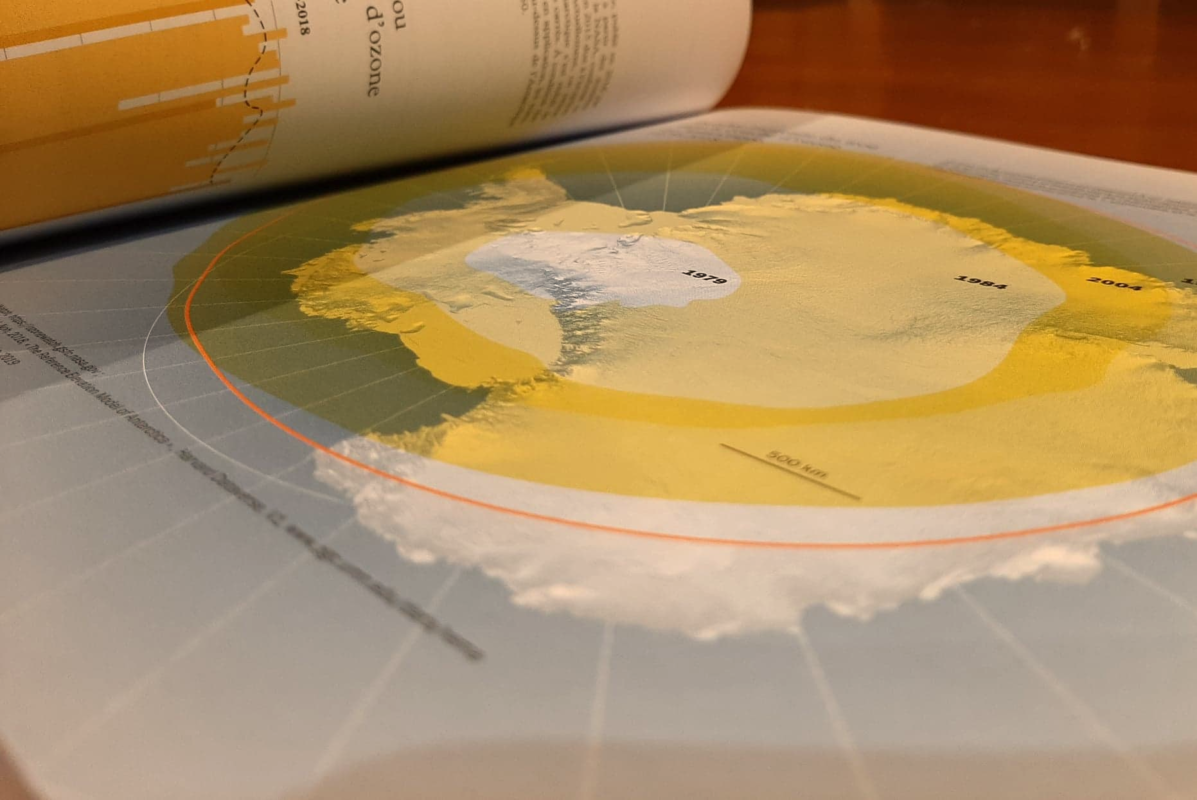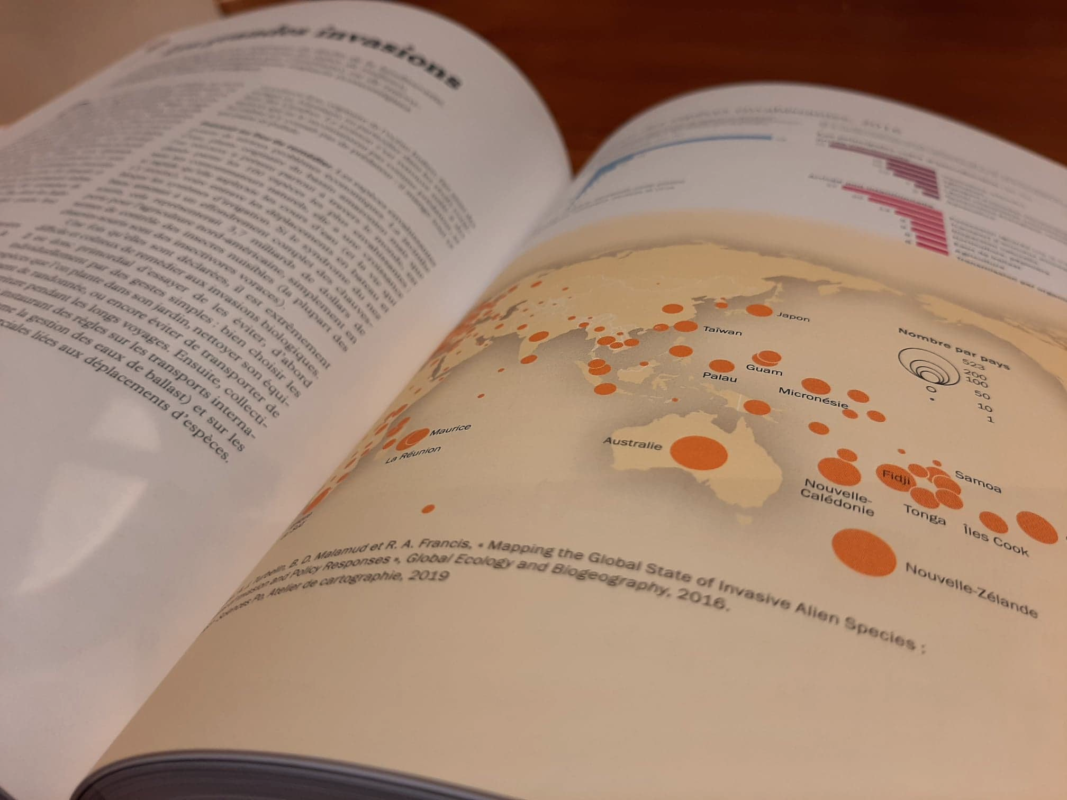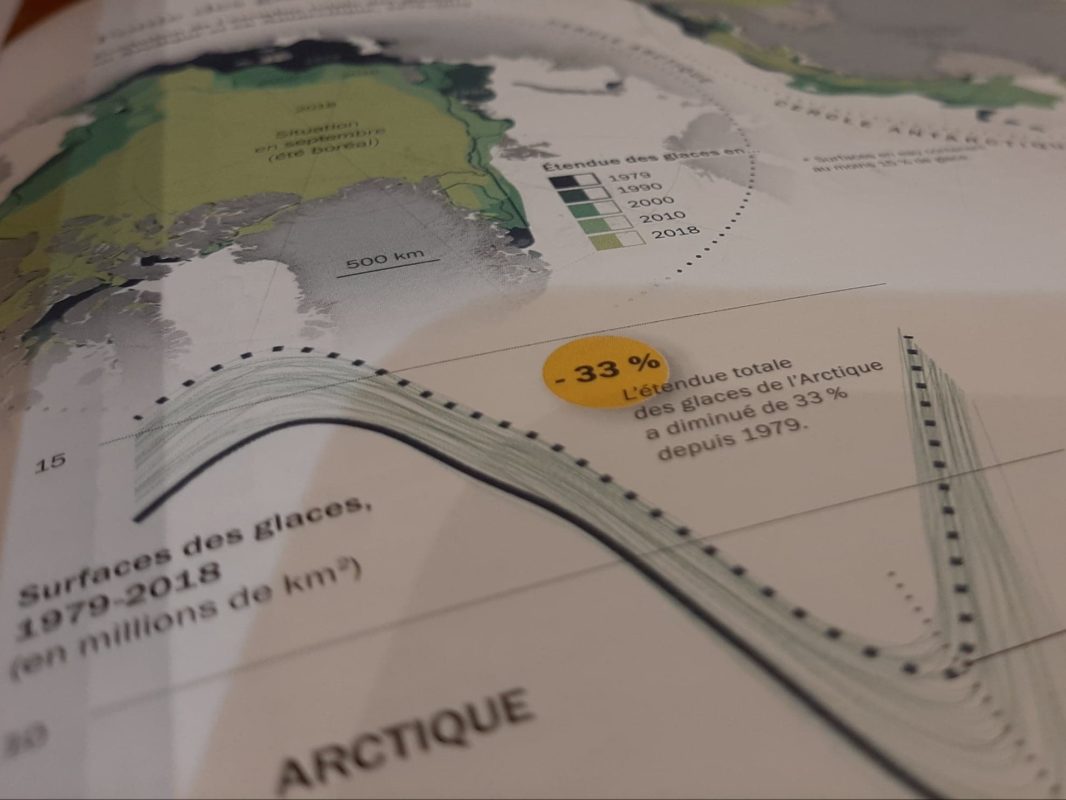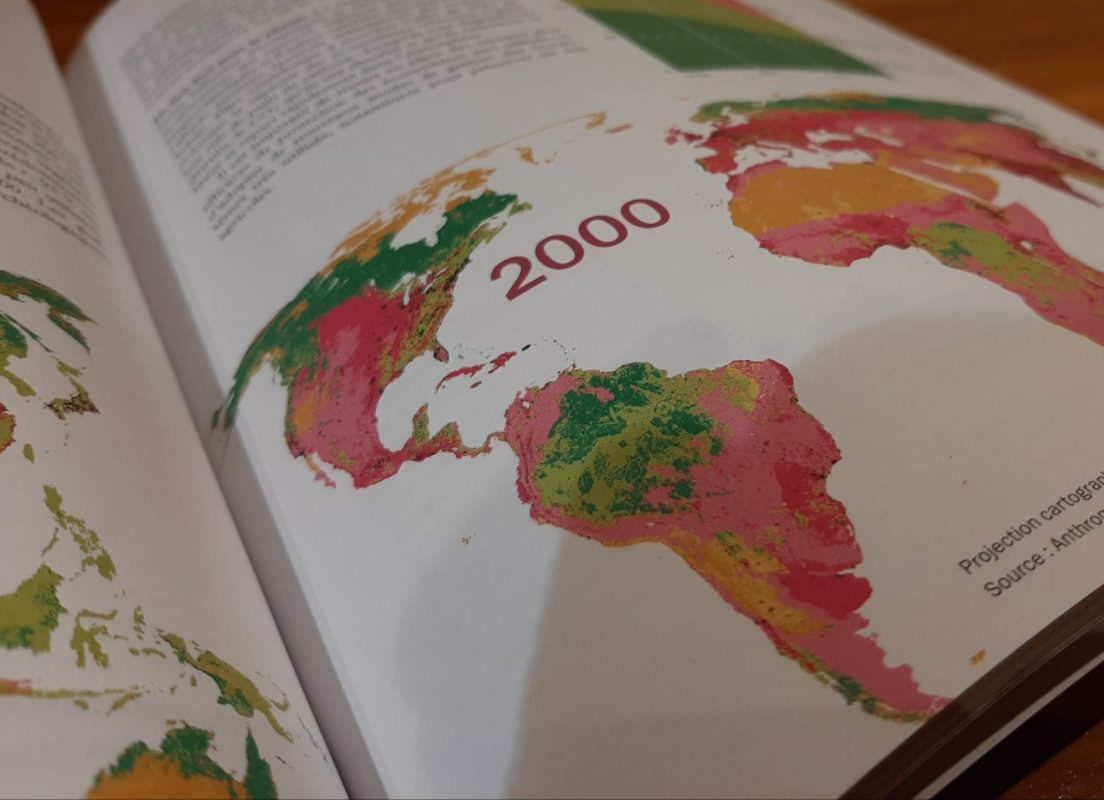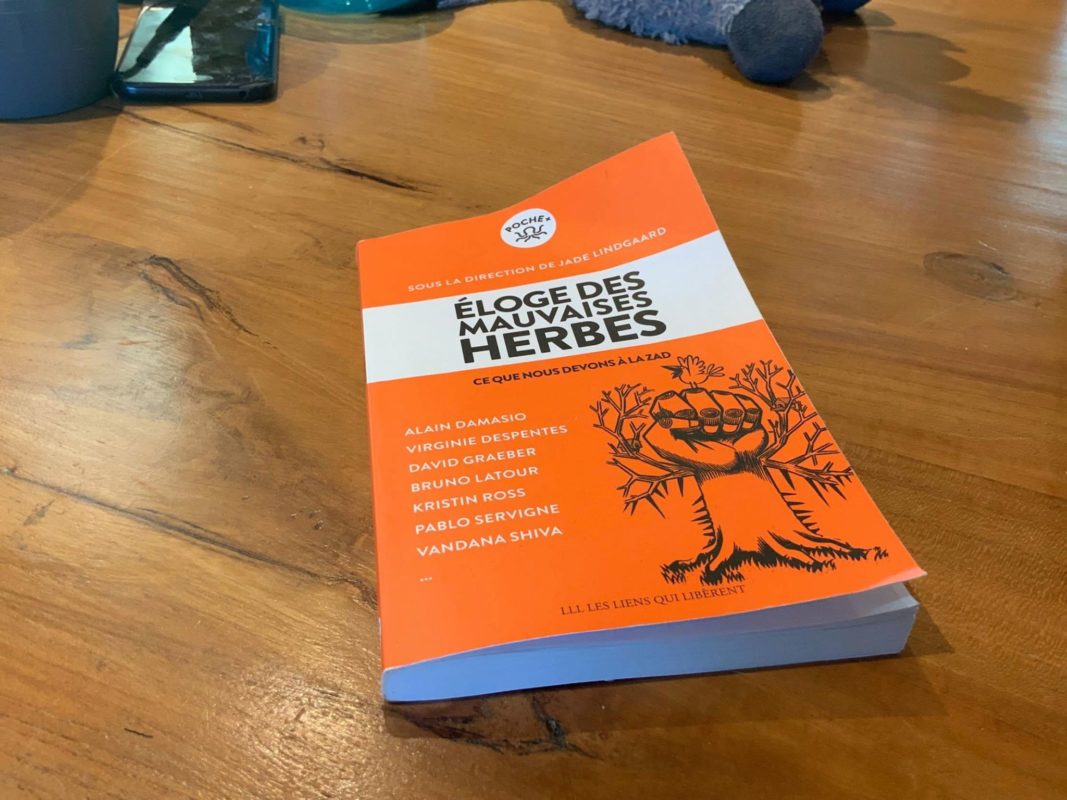26 centimètres de circonférence

Cette histoire, vous allez peut-être nous dire que vous la connaissez déjà, qu’elle ne vous impressionne pas, qu’elle vous en rappelle une autre. C’est vrai, elle nous remémore de vieilles histoires qu’on ne raconte plus guère, ou plus tant. Elle est de ces histoires qui, paradoxalement, incarnent l’avenir. Elle est de ces récits qu’on prend plaisir à réécrire, car ils laissent échapper une saveur nouvelle, une saveur presqu’oubliée. Et puis si toutes les histoires se ressemblent, celle-ci est la nôtre, elle est faite du grain de nos vies, elle est pétrie de nos choix et cela suffit assurément à lui donner le mérite d’être racontée.
Un début
Il est toujours difficile de commencer à raconter une histoire. Dans les romans, bien sûr, on plante un décor, on campe quelques personnages avant que ne survienne un élément déclencheur qui fait tout basculer, mais que faire quand les histoires sont réelles ? On doit bien découper la réalité pour en sortir une tranche alors où commencer ? Peut-être ai-je tort, mais j’ai envie de commencer notre histoire le 25 septembre 2019. Ce jour-là, Thomas m’a donné rendez-vous dans le village de Chauveheid, chez Albert Counasse.
Thomas est maraicher, permaculteur. Il aimerait sans doute dire qu’il sème, dans sa ferme-école, outre des radis et des laitues, les qualités qui font les paysans de demain. Albert, pour sa part, a choisi de devenir agriculteur bio il y a plus de quarante ans, à une époque où l’on n’imaginait pas à quel point cela allait devenir essentiel. Ses solides mains racontent bien plus d’histoires que je ne pourrais en inventer en une veillée entière d’affabulations. Aujourd’hui, ce sont ses enfants qui ont repris l’exploitation. Philippe cultive la terre et s’occupe du troupeau, Vincent transforme le lait des vaches en fromages. Au milieu d’eux, moi, de loin le plus jeune de l’équipage, je ne suis qu’un raconteur d’histoire dont les doigts s’usent sur les touches d’un clavier. Sans doute ai-je raconté les bonnes histoires aux bonnes personnes au bon moment puisque j’ai été élu pour incarner l’écologie dans la commune dont Albert, Thomas, Philippe et tant d’autres retournent la terre avec bien plus d’habileté que je n’en aurai jamais.

Quand germe plus qu’une idée
Mais ce jour-là, je n’ai rien à raconter, j’écoute et j’entends des noms qui croisent ma route pour la première fois : Zollerspelt, sérénité, Badensonne, Convoitise… A-t-on seulement idée du nombre de choix qui se posent rien qu’en misant sur une variété d’épeautre ? Sera-t-elle adaptée au climat et au type de sol qu’on prévoit pour elle ? Est-elle panifiable ? Est-elle certifiée bio ? Librement reproductible ? A-t-elle un bon rendement ? Son décorticage est-il facile ? Puisque nous savons qu’elle ne sera pulvérisée par aucun engrais chimique, peut-on être sûr qu’elle grandira comme il faut ? Puisqu’on sait qu’il ne sera pas question de l’arroser de fongicide, herbicide ou insecticide, saura-t-elle résister aux champignons, ravageurs et autres qui voudraient s’en prendre à elle ? Sera-t-elle plus rapide, plus robuste que les adventices qui viendront lui faire concurrence ? Ces choix que nous sommes en train de poser, attablés dans cette salle à manger de Chauveheid sont à la fois pragmatiques et politiques. Ils nous engagent sur un chemin, nous relient à des questions qui nous dépassent et nous précèdent. Avant nous, depuis huit-mille ans, d’autres humains se sont posé des questions semblables à propos de grains d’épeautres semblables, ils ont essayé, été déçus, ont vu leurs récoltes dépérir, ont sélectionné, hybridé… nous avons, sur l’homme du néolithique, l’avantage de 8000 ans d’essais et erreurs, mais avons à poser un choix tout aussi déterminant. Ce sera Zollerspelt.

Sur la terre comme au ciel
Choisir la terre, c’est à peu près aussi lourd de sens que choisir le grain qu’on y sème et c’est à nouveau un choix sous contrainte. Il est autant question d’azote que de contraintes législatives régionales, de propriété que d’exposition au soleil et d’expérience accumulée au fil des ans. C’est dans des moments pareils que le mot de « culture » revêt toute son ambigüité, toute sa polysémie. Car au fond, qu’est-ce qui relève de la culture au sens de « cultiver la terre » et qu’est-ce qui appartient aux constructions sociales de nos civilisations ? Le jour où Albert nous a amenés la première fois à Haute-Monchenoule, un arc-en-ciel enjambait le champ qui allait accueillir les semis. Symbole d’espoir, d’alliance ou de fertilité ? ça dépend des cultures.

Au fil des saisons
Germination en novembre, levée en décembre, hersage en février, montaison en mars, épiaison en mai, maturation en juin, pour arriver à maturité en aout, les céréales forcent la patience et poussent à guetter la météo chaque saison. L’hiver a été doux sur les contreforts ardennais. Pour l’épeautre, c’est plutôt une bonne chose.

Quant à nous, il a fallu que nous choisissions, avec Valérie Dumoulin du Parc Naturel des Sources, le jour du 27 février, le seul jour de tempête de neige pour sillonner les vallées du sud de la Belgique et partir à la rencontre des agriculteurs et des porteurs du projet « épeautre d’Ardenne » au parc naturel Haute Sûre-forêt d’Anlier. On roule au pas, on glisse, mais on trouve ce que l’on est venu chercher : un modèle d’acteurs qui ont réussi à travailler ensemble, ménageant à chacun sa juste place pour arriver à ce dont on rêve : un projet de territoire résilient et porteur de sens. Une résilience qui n’usurpe pas son nom : 5 agriculteurs, bios ou non, ont semé de l’épeautre sur 10 hectares. Les bonnes années, cela fait 50 tonnes de grains qui ne s’éloigneront pas de plus de 50 kilomètres du lieu où ils sont semés : Groupements d’Achat en Commun, Ruches, Marchés locaux, supérettes bios écoulent autant de farine, de pains, de pâtes et d’épeautre perlé qu’il en est produit chaque année. La balle d’épeautre, de son côté, finira en litière pour les animaux. Rien ne se perd, tout se transmet. C’est de cela qu’on rêve pour chez nous et comme les idées ne perdent pas de valeur quand elles sont partagées, on repart les poches pleines de chiffres, d’espoir et de mises en garde, de modèles et de bons conseils.

De l’eau au moulin
Il nous faut alors trouver un moulin. Quelqu’un qui accepte les six ou sept tonnes de grains que l’on espère récolter pour le transformer en trois tonnes de farine. C’est beaucoup et c’est peu à la fois.
C’est ridiculement peu pour un moulin industriel qui se rit d’une quantité si faible, c’est beaucoup pour un meunier ou une meunière seul·e qui portera sac après sac sur son épaule jusqu’à la pierre mue par la force de l’eau qui viendra le réduire en farine. Choisir un moulin, c’est comme choisir une variété d’épeautre ou une terre : c’est encore un choix pragmatique et politique.
Le moulin est-il équipé pour décortiquer l’épeautre ? Il faut que le meunier prenne une marge suffisante pour pouvoir nourrir sa famille et rentabiliser son outil, mais la farine ne doit pas être, au bout du compte, hors de prix. D’où viendra l’énergie qui servira à moudre le grain mûr ? Et si le moulin est trop loin de la ferme où le grain sèche patiemment, l’agriculteur perdra un temps précieux au détriment de ses bêtes qui n’ont cure d’attendre pour la traite que l’épeautre ait été amené au meunier. Olivier semble être notre homme. Le moulin de Lafosse qu’il a restauré patiemment presse des huiles et mout des farines à la force de l’eau… à condition que le débit soit suffisant. Un détail qui semble anecdotique, mais amène une part d’incertitude climatique supplémentaire au chemin qui va du grain au pain.
La belle étiquette
On n’était que quelques-uns autour de cet épeautre. Chaque étape de son histoire nous semblait importante à raconter, mais on savait aussi pertinemment que la communication publicitaire, si elle aime les récits, dédaigne ceux qui dépassent 1500 mots. Alors on s’est tourné vers un mot, trois petites lettres indissociables de l’esprit qui avait animé le projet à chacune de ses étapes. Il nous fallait une étiquette qui synthétise tout ce que contenait le paquet de farine. En anglais, étiquette se dit… label et en français, le label tout trouvé pour résumer ce qu’on avait fait, l’esprit dans lequel on l’avait fait c’était celui-là : B-I-O. Seulement, pour certifier un produit « Bio », il faut que tous les maillons de la chaine se fassent eux-mêmes labelliser, payent pour obtenir une certification, y compris si leur action se réduit à transformer en farine un grain qu’on vient passer sous une meule. Le choix est donc simple : faire monter le prix pour n’apporter aucun bénéfice au produit… ou choisir de construire la confiance autrement. Le grain était bio en entrant dans le moulin, il était devenu « cultivé sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse, sans additif ni conservateur ». C’est plus long, ça veut dire la même chose et ça traduit une confiance, pas celle d’un organisme de contrôle qui descend faire une visite à l’improviste, non, celle qui s’est construite jour après jour entre Albert, Valérie, Thomas, Damien, Olivier, Philippe et moi et ça, ça vaut sans doute plus qu’un label.

Fin de l’histoire ?
Alors voilà, elle est là, cette farine. En quantité modeste, certes, on n’en mout que 160 kg à la fois, ce qui suffirait à peine à nourrir pendant un mois quarante compagnons (du latin populaire companio : « celui avec qui on mange son pain »), mais on a écrit un premier chapitre de notre histoire. Est-ce la poule aux oeufs d’or? probablement pas. Ce n’était pas non plus le but : l’ambition était beaucoup moins modeste, oui, moins modeste : on voulait rapprocher un agriculteur et des consommateurs, on voulait réinsuffler du sens dans l’alimentation, on voulait veiller à la qualité à chaque étape du processus pour pouvoir regarder un compagnon dans les yeux et lui dire : ce dans quoi vous vous apprêtez à croquer est bon pour vous, bon pour la planète et bon pour la société dans laquelle on vit ensemble. C’était immodeste… et pourtant on y est arrivé.
Sans ce maudit, mais indispensable confinement, les amis du Laboratoire du pain de Changeons Demain, Alain, Vanessa, André, Shan et les autres nous auraient sans doute proposé de nous retrouver autour d’un four à pain, pourquoi pas celui de Lionel pour écouter Marc Dewalque, artisan boulanger malmédien à la retraite, partager le dernier chapitre de l’histoire, celui qui transforme une matière inerte en boule de pâte qui gonfle sous l’effet conjugué du feu et du levain. Renaud aurait été là pour jeter des ponts avec l’Histoire d’un grain qu’il a participé à semer un peu plus au Nord de l’arrondissement de Verviers. On aurait peut-être invité Pascal, Kevone et Cédric qui écrivent une histoire si semblable à la nôtre du côté des Petits Producteurs à Liège. On aurait invité Donatien et les agriculteurs du Parc Naturel Haute Sûre. Un barde aurait peut-être lu des passages de ce livre magnifique qui raconte l’histoire de Raphaël, de Leslie, de Sophie, de Paul et qui s’appelle Notre pain est politique. Un peu comme le banquet dans le village d’Astérix, ça aurait fait une chouette fin, vous ne trouvez pas ? Tant pis, cela doit vouloir dire que l’histoire ne s’arrête pas là. D’ailleurs, on s’apprête à semer à nouveau.
Et moi,et moi, et moi?
Tout au long de l’année qu’a duré ce projet, je me suis demandé ce que faisais là, moi qui n’apportais à l’équipage ni argent, ni terre, ni talent de cultivateur, de meunier ou de graphiste. La vérité, c’est que j’ai sans doute fait la seule chose que savent faire les raconteurs d’histoire depuis des millénaires : j’ai tissé des liens. Pour insuffler du sens, pour révéler ce qui est commun, entre les gens, entre les talents, des problèmes aux solutions, des choix aux décisions. Ni meunier, ni cultivateur, ni Parc Naturel ni boulanger… échevin, tisserand, conteur.